Archive
Noroc : le design au service d’une cause
Comme chaque année à la même époque, le VIA consacre une exposition aux créations d’étudiants en fin de cursus dans les principales écoles de design hexagonales. Julien Devaux, un designer de 26 ans fraîchement diplômé de l’ENSAD (section Design Objet) est l’un d’eux.
Son projet, baptisé « Noroc » (« santé » et « bonheur » en roumain), est le fruit d’un partenariat avec Moldavenir, une association de solidarité internationale dont l’action se concentre sur l’un des pays les plus pauvres d’Europe : la Moldavie. Touché par de graves difficultés économiques, le pays connaît depuis quelques années une véritable hémorragie démographique. L’objectif de l’association est de venir en aide aux populations rurales, en mettant en place des actions leur permettant de vivre dignement de leur travail, en restant sur place.
C’est dans ce cadre que s’inscrit Noroc. Initié en janvier 2010, ce projet a pour finalité la création d’un atelier de production artisanale à Dubăsarii Vechi, un village de 6 000 habitants situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale moldave (Chişinău). L’idée est simple : capitaliser sur les savoir-faire traditionnels, les valoriser et encourager leur transmission afin de donner de nouvelles perspectives économiques aux jeunes du village, et une alternative à l’émigration.
La vannerie est l’un de ces savoir-faire. C’est celui qu’a choisi Julien Devaux pour concevoir une première collection de mobilier artisanal (tabouret, table basse, luminaire, corbeille à papier et vide-poches), où l’osier tressé vient se greffer sur des objets récupérés dans les décharges sauvages qui pullulent dans la campagne moldave.
Économie solidaire, écologie et valorisation de l’artisanat grâce au design : Noroc aborde intelligemment plusieurs problématiques bien contemporaines, et parvient en même temps à séduire par la beauté des objets auxquels il donne vie. Un autre design est possible. Explications par Julien Devaux.
Quelle a été la genèse de ce projet ?
Julien Devaux : Mon mémoire de quatrième année à l’ENSAD portait sur le design et l’aide humanitaire. Au cours de mes recherches, j’ai rencontré différents acteurs humanitaires, dont Moldavenir. J’ai été séduit par leurs valeurs et par leur approche, qui place l’individu au centre de leur action. Je leur ai donc proposé de développer un projet et ils m’ont suggéré de me rendre sur place, en Moldavie, afin d’évaluer les besoins de la population locale. Un mois après le premier contact, j’étais déjà sur le terrain, dans le village de Dubăsarii Vechi. Et comme je viens d’une école de création, je me suis vite retrouvé dans les ateliers des artisans…
Quels sont les savoir-faire que vous avez découverts ?
J. D. : L’artisanat est énormément présent là-bas et, du fait de l’absence de ressources et de moyens, les gens sont tous très bricoleurs. Il y a beaucoup de menuisiers, de meuniers, du tissage, de la broderie, de la poterie… L’après-midi, les enfants vont tous dans de petits centres de formation où ils bricolent et apprennent certaines techniques artisanales comme la sculpture sur bois. Comme j’avais peu de temps pour développer mon projet de diplôme, j’ai dû faire des choix et me suis tourné vers la vannerie, qui est une tradition locale. Mais dans la suite du projet, il est prévu de s’intéresser à d’autres savoir-faire.
Quelle est l’utilisation traditionnelle de la vannerie ? Quels types d’objets sont fabriqués?
J. D. : Il y a une énorme production à Pâques, pour produire des paniers en osier. Cela fait partie de la tradition orthodoxe. La vannerie servait aussi aux activités agricoles, pour transporter et conserver les récoltes, mais ces objets ont bien sûr été remplacés par les matières plastiques.
Que connaissiez-vous de la vannerie avant d’y aller ?
J. D. : Rien du tout ! J’ai découvert ça là-bas, mais j’adore travailler la matière, donc je m’y suis mis aussi. J’ai commencé à me renseigner sur Internet, puis j’ai rencontré des artisans : sur place mais aussi en France, car les techniques sont à peu près les mêmes, avec deux ou trois variantes.
Comment vous est venue cette idée d’objets hybrides, à base de vannerie et d’objets trouvés ?
J. D. : Lors de mon deuxième voyage, j’ai rencontré quelques problèmes pour monter le projet : c’était au mois d’avril et les personnes étaient occupées aux champs. J’ai donc profité de mon temps libre pour me balader autour du village. C’est à ce moment-là que j’ai découvert le problème de la gestion des déchets : il n’y a pas de ramassage des déchets dans les villages. Les habitants les conservent et essayent d’en brûler le plus possible. Le reste est stocké dans le jardin jusqu’à ce qu’il y en ait trop. À ce moment-là, quelqu’un vient déblayer. Les déchets sont emmenés dans des « décharges » à ciel ouvert où tout s’envole, tout dégringole, il y en a partout. Et là, j’ai découvert une vraie richesse, une mine d’or d’objets à récupérer. De beaux objets qu’il fallait juste un peu poncer. D’un seau qui n’avait plus de fond, donc plus d’utilité, on pouvait faire un petit luminaire…
Avez-vous conçu les objets seul ou en collaboration avec les artisans locaux ?
J. D. : Je pensais au début que les modèles allaient naître d’une énergie de rencontre entre les artisans, les jeunes et moi-même… Ça n’a pas été le cas. Il est très difficile de créer une dynamique si l’on n’arrive pas avec des modèles et des financements. J’ai donc dessiné la collection sur place, dans le vif du sujet, en très peu de temps et de manière intuitive. L’idée était de montrer qu’il était possible de faire des choses différentes de ce qu’ils avaient l’habitude de faire, à partir des mêmes techniques et des mêmes matériaux. L’utilisation des déchets pouvait aussi être un point de départ intéressant. La récupération fait déjà partie de leurs usages : j’ai vu de la vannerie avec du fil électrique de téléphone par exemple… J’ai présenté les modèles aux artisans et c’est à partir de là que s’est initié un dialogue. En fonction de la faisabilité, il y a eu des retours de leur part, on a beaucoup parlé. Ils aiment transmettre leur savoir-faire, qu’on s’intéresse à leur travail…
Justement, y a-t-il déjà une transmission de ce savoir-faire entre les générations ?
J. D. : Il y a quelques ateliers où le fils suit le père, où la fille travaille avec la mère sur le métier à tisser, mais très peu. C’est justement l’un des objectifs de mon projet : valoriser le travail des jeunes qui apprennent avec leurs parents. La grosse catastrophe de ce pays, ce qui m’a vraiment marqué, c’est que les jeunes ont très peu d’espoir d’avenir dans leur village ou dans leur pays. Donc ils se tournent vers l’étranger, où ils espèrent trouver un boulot bien rémunéré, et partent plusieurs années. Il y a énormément de familles éclatées. C’est pourquoi j’aimerais vraiment travailler avec les jeunes artisans, pour les soutenir dans leur activité.
L’idée est donc de poursuivre le projet ?
J. D. : Oui, les objets qui sont exposés à la galerie du VIA ne sont que des prototypes. L’objectif à présent est de lancer une production locale et d’ouvrir un marché à l’export pour soutenir les artisans et leur permettre de rester dans leur village. Les artisans travaillent aussi beaucoup pour répondre aux besoins locaux, donc il est aussi important de maintenir cet équilibre.
Les objets que vous avez conçus sont-ils nécessairement des pièces uniques ?
J. D. : Le travail à partir d’objets de récupération impose en effet le principe de pièce unique. On peut concevoir une série de tabourets, mais chacun sera unique. Ce qui implique à chaque fois d’engager une réflexion sur l’objet de départ, d’analyser son état de dégradation et de trouver des solutions adaptées à chacun. Donc ce ne sera pas un travail automatique, ce qui me paraît intéressant, en plus de l’aspect écologique. Seulement, c’est aussi une contrainte parce qu’il est impossible de savoir par avance combien d’objets il sera possible de récupérer. Si on envisage une production en petite série, cela risque d’être un problème. Ça fait partie des questions sur lesquelles on réfléchit en ce moment…
À présent que vous êtes diplômé, quels sont vos projets ?
J. D. : Je suis en pleine réflexion. Ce projet-là me plait, et j’aimerais le mener à terme. De manière générale, je m’intéresse aux problématiques sociales, solidaires : penser la production différemment qu’à l’heure actuelle, penser plus local, penser aux consommateurs aussi… à la problématique des objets que l’on consomme. Pour Noroc, j’ai travaillé en Moldavie, mais s’il était possible de faire la même chose en France, je serais ravi.
Quand Vallauris s’ouvrait au design
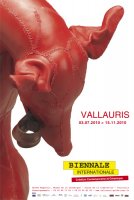 Roulez tambours, sonnez trompettes : la Biennale de Vallauris, qui fête cette année son quarantième anniversaire, vient d’ouvrir ses portes. Rebaptisée pour l’occasion « Biennale Internationale de Vallauris – Création contemporaine et céramique » (vous pouvez respirer), la manifestation entend plus que jamais « inscrire la création céramique dans le monde de l’art contemporain ». Au programme, une dizaine d’expositions monographiques ou thématiques (et autant de conférences) permettant de découvrir un large panel d’artistes et de designers contemporains travaillant avec ce médium.
Roulez tambours, sonnez trompettes : la Biennale de Vallauris, qui fête cette année son quarantième anniversaire, vient d’ouvrir ses portes. Rebaptisée pour l’occasion « Biennale Internationale de Vallauris – Création contemporaine et céramique » (vous pouvez respirer), la manifestation entend plus que jamais « inscrire la création céramique dans le monde de l’art contemporain ». Au programme, une dizaine d’expositions monographiques ou thématiques (et autant de conférences) permettant de découvrir un large panel d’artistes et de designers contemporains travaillant avec ce médium.
En guise d’Happy birthday, et en attendant de découvrir ce nouveau cru prometteur, petit retour sur une expérience originale, hélas terminée, mais dont il faut sans doute voir la trace dans les collaborations qui continuent de se tisser entre designers et artisans potiers vallauriens.
En 1998, la délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture et la Ville de Vallauris lancent l’opération Des designers à Vallauris. A cette date, la Biennale n’est encore qu’un concours (il faudra attendre 2006 pour qu’un nouveau commissaire, Yves Peltier, y ajoute des expositions temporaires) et l’âge d’or de la « ville aux cent potiers », associée à la figure de Picasso, n’est déjà plus qu’un souvenir.
Pourtant, Vallauris compte encore des artisans de talent, qui perpétuent la technique traditionnelle du tournage… L’idée de ce nouveau programme est résumée dans son titre : créer des rencontres entre designers et potiers locaux, les faire travailler ensemble autour de recherches qui devront aboutir à la production de petites séries destinées à être commercialisées. Les objectifs sont eux aussi évidents : d’un côté, il s’agit de sensibiliser les designers aux potentialités de la céramique ; de l’autre, de dynamiser la production locale en confrontant les potiers à d’autres approches de leur médium.
Chaque année jusqu’en 2002, deux designers vont donc venir plancher sur le thème de la céramique utilitaire, la seule contrainte imposée par le programme. Olivier Gagnère et Martin Szekely ouvrent le bal en 1998, avec (respectivement) les ateliers Gerbino et Mathieu. Frédéric Ruyant et Patrick Jouin le concluent cinq ans plus tard. Les visiteurs de l’exposition que le Centre Pompidou vient de consacrer à ce dernier designer ont pu découvrir (ou redécouvrir) quelques pièces nées de ces collaborations : trois plats en terre cuite, conçus par Patrick Jouin et réalisés par le potier Gérard Crociani.
Chacun de ces plats se compose de deux parties. Sur le principe du plat à tajine, Chaud-chaud sert autant à la cuisson qu’à la dégustation : au moment de passer à table, le couvercle passe sous l’assiette, et lui sert de support. Le saladier Froid-froid est lui aussi doté d’un couvercle, mais percé d’un trou pour remuer la salade sans risquer d’en mettre partout. Enfin, Chaud-froid associe deux contenants concentriques : le plus grand, qui reçoit le froid, est pourvu d’un cratère central qui accueille le plus petit, destiné au chaud.
Lorsqu’il arrive à Vallauris, Patrick Jouin collabore déjà avec le chef Alain Ducasse. Il est donc sensibilisé aux problématiques de la restauration et les intègre à ses recherches. Les trois plats qu’il imagine devront être suffisamment résistants pour une utilisation dans un cadre professionnel (utilisation intensive, lavage en machine, cuisson à hautes températures), intégrer les contraintes d’une production en petite série et refléter les valeurs associées à la cuisine : partage, générosité, convivialité. Comme à son habitude, le designer privilégie des formes simples et organiques. La couleur de chaque pièce identifie sa fonction et le type de contenu qu’elle peut accueillir.
Pour passer de l’idée à la matière, Gérard Crociani n’aura besoin d’aucun dessin technique. Quelques croquis, un échange direct avec le designer et sa connaissance parfaite du matériau lui permettront de donner vie à ces objets qui, malgré leur apparente simplicité, représentent un véritable tour de force technique (notamment pour faire s’emboîter les plats).
Si le programme « Designers à Vallauris » s’est achevé avec cette belle rencontre, les designers n’ont pas pour autant déserté les ateliers vallauriens. Le visiteur de la Biennale pourra notamment s’en convaincre en découvrant L’âge du monde, une collection de contenants conçus par Mathieu Lehanneur et réalisés en 2009 à Vallauris par Claude Aïello. Ce projet vient d’être distingué par le Prix de la ville de Vallauris, Section design.






